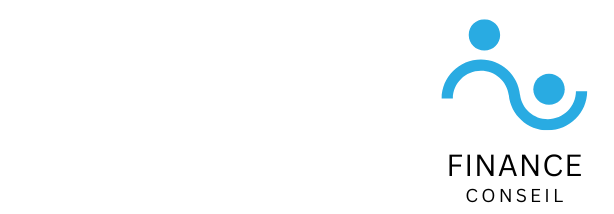La subordination constitue la pierre angulaire du contrat de travail dans le système juridique français. Ce concept, né avec l’industrialisation au XIXe siècle, distingue fondamentalement la relation de travail des autres relations contractuelles comme la prestation de service. Selon la Cour de cassation, la subordination se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui détient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». Cette définition, établie en 1996, continue d’évoluer face aux transformations du monde du travail, notamment l’émergence des plateformes numériques et du télétravail, remettant en question les contours traditionnels de ce lien de subordination.
Genèse et évolution historique de la subordination dans le droit du travail
Le concept de subordination trouve ses racines dans la révolution industrielle du XIXe siècle. Avant cette période, les relations de travail s’inscrivaient principalement dans le cadre du louage d’ouvrage, régi par le Code civil de 1804. La transformation des modes de production a progressivement fait émerger un nouveau type de relation où le travailleur se plaçait sous l’autorité d’un patron.
C’est en 1931 que la Cour de cassation consacre pour la première fois le critère de subordination comme élément déterminant du contrat de travail dans l’arrêt Bardou. Cette décision historique stipule que « la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat conclu entre les parties ». Le juge établit ainsi que c’est l’existence d’un lien juridique de subordination, et non la dépendance économique, qui caractérise le contrat de travail.
Durant les Trente Glorieuses (1945-1975), la subordination s’est profondément ancrée dans le modèle fordiste d’organisation du travail, caractérisé par une hiérarchie verticale et des tâches précisément définies. Cette période a vu la consolidation d’un droit du travail protecteur, où la subordination justifiait l’octroi de garanties sociales en contrepartie de la soumission du salarié au pouvoir patronal.
Les années 1980-1990 ont marqué un tournant avec l’apparition de nouvelles formes d’organisation du travail plus horizontales et l’émergence du management participatif. La subordination est devenue plus diffuse et subtile, s’exprimant davantage par des objectifs à atteindre que par des ordres directs. L’arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 a redéfini la subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui possède trois pouvoirs distincts : diriger, contrôler et sanctionner.
Le XXIe siècle a vu l’émergence de questionnements profonds sur la pertinence du critère classique de subordination face à des relations de travail de plus en plus hybrides. Les frontières s’estompent entre salariat et travail indépendant, conduisant les tribunaux à développer la notion de subordination économique et à reconnaître l’existence de zones grises où le critère unique de subordination juridique ne suffit plus à qualifier adéquatement la relation de travail.
Les manifestations concrètes du pouvoir de subordination
Le lien de subordination se manifeste quotidiennement à travers différentes expressions du pouvoir patronal. Parmi ces manifestations, le pouvoir de direction occupe une place prépondérante. Ce pouvoir permet à l’employeur de déterminer unilatéralement les conditions d’exécution du travail : horaires, lieu de travail, méthodes à utiliser, ou encore objectifs à atteindre. L’article L.1121-1 du Code du travail encadre ce pouvoir en précisant que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le pouvoir disciplinaire constitue une autre manifestation caractéristique de la subordination. Selon une étude du ministère du Travail de 2019, environ 72% des entreprises françaises de plus de 50 salariés ont formalisé ce pouvoir dans un règlement intérieur. Ce pouvoir permet à l’employeur de sanctionner les manquements du salarié aux obligations résultant de son contrat, allant du simple avertissement jusqu’au licenciement pour faute grave. L’exercice de ce pouvoir est néanmoins strictement encadré par les articles L.1331-1 et suivants du Code du travail, qui imposent notamment le respect d’une procédure contradictoire et le principe de proportionnalité des sanctions.
Le contrôle de l’activité comme marqueur de subordination
Le pouvoir de contrôle se traduit par la surveillance de l’activité du salarié. Ce contrôle peut prendre des formes multiples, depuis les méthodes traditionnelles comme le pointage jusqu’aux technologies numériques sophistiquées. Une décision de la CNIL de mars 2022 indique que 47% des entreprises françaises utilisent des outils numériques de suivi d’activité de leurs salariés. La jurisprudence a précisé les limites de ce pouvoir, notamment dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, qui a consacré le droit du salarié au respect de sa vie privée, y compris pendant son temps de travail.
L’obligation d’évaluation professionnelle représente une forme plus moderne de la subordination. Selon les données de la DARES de 2021, 83% des cadres et 64% des employés font l’objet d’une évaluation annuelle formalisée. Ces évaluations, qui conditionnent souvent l’évolution professionnelle et salariale, constituent un levier puissant du pouvoir managérial. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2013, a reconnu que les méthodes d’évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie et ne peuvent légitimement se fonder sur des critères subjectifs.
Enfin, le pouvoir d’organisation collective permet à l’employeur de définir la structure même de l’entreprise : organigramme, répartition des tâches, modalités de collaboration entre services. Ce pouvoir s’est considérablement transformé avec l’avènement des organisations matricielles et des méthodes agiles, où l’autorité devient plus diffuse mais demeure présente sous forme d’injonctions à l’autonomie et à la responsabilisation.
- Enquête DARES 2020 : 38% des salariés français déclarent recevoir des ordres contradictoires, signe d’une subordination complexifiée par la multiplication des lignes hiérarchiques
- Étude ANACT 2021 : 52% des cadres ressentent une pression accrue liée à l’obligation de résultats, nouvelle forme de subordination par objectifs
Les limites juridiques au pouvoir de subordination
Si la subordination constitue l’essence du contrat de travail, elle n’est pas pour autant illimitée. Le législateur et les juges ont progressivement élaboré un corpus de garde-fous juridiques visant à préserver les droits fondamentaux du salarié face au pouvoir patronal. La première de ces limites réside dans le respect des libertés individuelles, consacré par l’article L.1121-1 du Code du travail. Ce principe a été renforcé par la jurisprudence, notamment dans l’arrêt Corona du 17 avril 1991, où la Cour de cassation a établi que « le salarié est libre de choisir son domicile personnel et familial » et que cette liberté ne peut être restreinte par l’employeur qu’en cas de nécessité démontrée.
Le droit à la santé et à la sécurité constitue une autre limite majeure au pouvoir de subordination. L’obligation de sécurité de résultat, dégagée par les arrêts Amiante du 28 février 2002, a considérablement renforcé la responsabilité de l’employeur. Cette obligation s’est étendue à la prévention des risques psychosociaux, comme l’a confirmé l’arrêt Snecma du 5 mars 2008, où la Cour de cassation a validé la suspension d’une réorganisation susceptible de compromettre la santé des salariés. Les chiffres de la CNAM-TS pour 2021 révèlent que 42% des arrêts de travail de longue durée sont liés à des troubles psychosociaux, soulignant l’enjeu majeur que représente cette limite à la subordination.
La protection contre les discriminations encadre significativement le pouvoir patronal. L’article L.1132-1 du Code du travail énumère 25 critères prohibés de discrimination, tandis que le Défenseur des Droits a reçu en 2022 plus de 6 800 réclamations concernant des discriminations en milieu professionnel. La jurisprudence a développé des mécanismes probatoires favorables aux victimes, comme l’aménagement de la charge de la preuve, permettant de contrebalancer la relation asymétrique inhérente à la subordination.
Le droit d’expression des salariés, institué par les lois Auroux de 1982, représente un contrepoids collectif au pouvoir de subordination. Ce droit permet aux travailleurs de s’exprimer directement sur le contenu et l’organisation de leur travail. Il s’est enrichi avec la reconnaissance du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement (loi du 16 avril 2013), puis du statut protecteur des lanceurs d’alerte (loi Sapin II du 9 décembre 2016). Une étude de l’Institut du travail de Strasbourg (2020) montre néanmoins que seules 23% des entreprises organisent effectivement des espaces d’expression directe des salariés, illustrant les difficultés pratiques d’exercice de ce droit.
Le contrôle judiciaire constitue enfin un rempart essentiel contre les abus de subordination. Les tribunaux sanctionnent régulièrement l’excès de pouvoir patronal, comme dans l’arrêt du 29 juin 2011 où la Cour de cassation a jugé abusif le licenciement d’un salarié ayant refusé de changer de poste en l’absence de clause de mobilité. Les statistiques du ministère de la Justice révèlent qu’en 2021, 62% des demandes portées devant les Conseils de Prud’hommes concernaient des contestations liées à l’exercice du pouvoir patronal, témoignant de l’importance du juge comme régulateur de la relation de subordination.
La subordination à l’épreuve des nouvelles formes de travail
L’émergence du télétravail comme modalité d’organisation pérenne a profondément bouleversé l’expression traditionnelle de la subordination. Selon l’INSEE, en 2022, 27% des actifs français pratiquent régulièrement le télétravail, contre seulement 7% en 2019. Cette distanciation physique remet en question les mécanismes classiques de contrôle et de surveillance. La subordination se transforme, passant d’un contrôle des moyens à une évaluation des résultats. L’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 a confirmé que le refus du salarié de transmettre quotidiennement un compte-rendu détaillé de son activité en télétravail ne constitue pas une insubordination, marquant ainsi les limites du pouvoir de contrôle à distance.
L’économie des plateformes soulève des questions fondamentales sur la requalification des relations contractuelles. En France, plus de 200 000 personnes travaillent pour des plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo. La Cour de cassation, dans l’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018, puis dans l’arrêt Uber du 4 mars 2020, a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre ces plateformes et leurs prestataires, conduisant à la requalification en contrat de travail. Le juge a identifié des indices modernes de subordination : géolocalisation permanente, systèmes de notation, pouvoir de déconnexion, algorithmes dictant l’activité. Ces décisions illustrent l’adaptation du concept de subordination aux réalités contemporaines.
Le développement du management par objectifs introduit une forme plus subtile de subordination. Selon l’APEC, 78% des cadres français sont désormais évalués sur la base d’objectifs préalablement fixés. Cette modalité de subordination, moins visible mais tout aussi contraignante, a été qualifiée par certains sociologues de « servitude volontaire ». La jurisprudence a progressivement encadré cette pratique, notamment dans un arrêt du 22 janvier 2014 où la Cour de cassation a jugé que des objectifs irréalistes peuvent constituer un harcèlement moral, reconnaissant ainsi les dérives potentielles de cette forme moderne de subordination.
L’essor du portage salarial et des coopératives d’activité crée des situations hybrides où coexistent autonomie professionnelle et subordination juridique. Ces formes d’emploi concernent plus de 85 000 personnes en France en 2022. La loi du 8 août 2016 a consacré le portage salarial comme une relation triangulaire où le salarié porté dispose d’une autonomie dans l’organisation de sa mission tout en bénéficiant du statut protecteur du salariat. Cette reconnaissance légale témoigne de l’émergence d’une subordination atténuée, adaptée aux aspirations d’autonomie des travailleurs contemporains.
Face à ces transformations, le concept même de subordination connaît une mue profonde. Plusieurs propositions émergent pour adapter le droit du travail à ces nouvelles réalités : création d’un statut intermédiaire entre salariat et indépendance, élargissement des critères de qualification du contrat de travail au-delà de la seule subordination juridique, ou encore développement d’un socle de droits sociaux attachés à la personne indépendamment de son statut. Ces réflexions témoignent de la nécessité de repenser la subordination comme fondement exclusif de la protection sociale.
Vers une redéfinition du paradigme de subordination
La subordination classique, conçue dans un contexte industriel, semble aujourd’hui en décalage avec les aspirations professionnelles contemporaines. Une étude BVA de 2022 révèle que 67% des actifs français privilégient l’autonomie professionnelle comme critère principal de satisfaction au travail, devant la rémunération (58%). Cette évolution sociologique majeure se heurte à la persistance d’un droit du travail fondé sur la dichotomie subordination/protection. Des philosophes du travail comme Dominique Méda proposent de substituer au paradigme de subordination celui de « coopération régulée », où l’autorité découlerait non plus du contrat mais de la compétence et de la légitimité.
Au niveau européen, la flexicurité a tenté d’apporter une réponse à cette tension entre aspiration à l’autonomie et besoin de sécurité. Le modèle danois, souvent cité en exemple, dissocie partiellement la protection sociale de la subordination en garantissant des droits élevés aux travailleurs indépendamment de leur statut. En France, le Compte Personnel d’Activité, créé en 2017, s’inscrit dans cette logique en attachant certains droits à la personne plutôt qu’à son contrat de travail. Toutefois, ces évolutions demeurent limitées face à l’ampleur des transformations en cours.
La codétermination, inspirée du modèle allemand de Mitbestimmung, offre une perspective de dépassement de la subordination unilatérale. En permettant aux salariés de participer aux décisions stratégiques via leur présence dans les conseils d’administration, ce modèle transforme la subordination en participation. En France, la loi PACTE de 2019 a timidement renforcé la présence des administrateurs salariés, mais reste loin du modèle allemand où les représentants des salariés peuvent constituer jusqu’à la moitié du conseil de surveillance dans les grandes entreprises.
Vers un droit de l’activité professionnelle?
Plusieurs juristes, dont Alain Supiot dans son rapport de 1999 « Au-delà de l’emploi », plaident pour l’avènement d’un droit de l’activité professionnelle qui engloberait l’ensemble des formes de travail au-delà du seul salariat subordonné. Cette approche viserait à garantir des protections fondamentales à tous les travailleurs, quelle que soit la qualification juridique de leur relation d’emploi. Le rapport Frouin de 2020 sur la régulation des plateformes numériques s’inscrit partiellement dans cette perspective en proposant des protections spécifiques pour les travailleurs de plateforme sans nécessairement les requalifier en salariés.
L’intelligence artificielle et l’automatisation annoncent de nouvelles métamorphoses de la subordination. Une étude de l’OCDE de 2021 estime que 16,4% des emplois en France présentent un risque élevé d’automatisation dans les 15 prochaines années. Cette transformation pourrait paradoxalement renforcer la subordination des travailleurs aux algorithmes tout en réduisant le besoin de main-d’œuvre subordonnée. Face à ce paradoxe, des propositions émergent comme le revenu universel d’activité ou la réduction collective du temps de travail, qui visent à desserrer l’étau de la dépendance économique fondant la subordination.
La crise sanitaire de 2020-2021 a servi de révélateur et d’accélérateur à ces questionnements sur la subordination. Le déploiement massif du télétravail a démontré la possibilité d’une subordination allégée, tandis que l’explosion des reconversions professionnelles (38% des actifs français envisagent une reconversion selon une enquête IFOP de 2022) témoigne d’une recherche d’autonomie accrue. Ces évolutions dessinent les contours d’un nouveau contrat social où la subordination ne serait plus le prix à payer pour la sécurité, mais céderait la place à un équilibre plus harmonieux entre autodétermination et protection collective.
- Rapport France Stratégie 2022 : 74% des jeunes actifs (18-35 ans) considèrent la subordination hiérarchique comme un frein à leur épanouissement professionnel
- Baromètre Malakoff Médéric 2021 : les entreprises pratiquant un management fondé sur l’autonomie plutôt que sur le contrôle affichent un taux d’engagement des salariés supérieur de 27% à la moyenne
La subordination négociée : nouvel horizon du droit du travail
Face aux limites du modèle binaire opposant subordination et indépendance, une troisième voie émerge : celle de la subordination négociée. Cette approche repose sur l’idée que les conditions d’exercice du pouvoir patronal peuvent faire l’objet d’une détermination contractuelle ou conventionnelle. Les accords de performance collective, introduits par les ordonnances Macron de 2017, s’inscrivent partiellement dans cette logique en permettant d’adapter temporairement les conditions de travail aux nécessités économiques via la négociation collective. En 2021, 485 accords de ce type ont été signés en France, témoignant d’une certaine appropriation de ce dispositif.
Le droit à la déconnexion, consacré par la loi Travail de 2016, illustre la possibilité d’encadrer négativement la subordination. En reconnaissant au salarié le droit de ne pas être constamment joignable, le législateur a introduit une limitation temporelle au pouvoir de direction. Selon l’Observatoire de la vie au travail, 43% des entreprises françaises ont formalisé ce droit dans un accord ou une charte en 2022. Cette avancée, bien qu’insuffisante face à l’intensification du travail numérique, démontre la possibilité de circonscrire contractuellement l’étendue de la subordination.
L’essor du management participatif et des entreprises libérées traduit une aspiration à transformer qualitativement la subordination. Des entreprises comme Decathlon ou Michelin ont expérimenté des formes d’organisation où l’autorité hiérarchique cède la place à l’autocontrôle par les pairs et à la responsabilisation. Une étude de l’ANACT de 2020 montre que ces organisations présentent un taux d’absentéisme inférieur de 32% à la moyenne sectorielle, suggérant un lien entre transformation de la subordination et bien-être au travail. Toutefois, certains sociologues comme Danièle Linhart alertent sur le risque d’une « servitude volontaire » où le contrôle externe serait remplacé par une intériorisation des contraintes.
À l’échelle internationale, le concept de travail décent promu par l’Organisation Internationale du Travail depuis 1999 propose une approche renouvelée de la subordination. En définissant quatre piliers (emploi, protection sociale, droits fondamentaux et dialogue social), l’OIT suggère que la subordination n’est acceptable que si elle s’accompagne de garanties substantielles. Cette vision a influencé l’adoption en 2019 de la directive européenne sur les conditions de travail transparentes et prévisibles, qui reconnaît des droits minimaux à tous les travailleurs, y compris ceux des plateformes.
L’avenir du travail pourrait se dessiner autour d’un contrat social renouvelé où la subordination ne serait plus subie mais choisie, limitée et compensée. Cette transformation profonde nécessiterait une refonte du droit du travail autour de trois principes : la proportionnalité (le degré de subordination doit être proportionnel à la protection offerte), la temporalité (la subordination peut varier selon les phases de la vie professionnelle) et la réversibilité (possibilité de passer d’un statut à l’autre sans perte de droits). Ces principes esquissent un modèle où la subordination ne serait plus le fondement exclusif de la protection sociale, mais une modalité parmi d’autres d’organisation du travail, compatible avec l’aspiration contemporaine à l’autonomie sans sacrifier la sécurité.